TROISIÈME EXPLICATION
LA DÉCONSIDÉRATION DES PUTSCHISTES
DANS LEUR ENSEMBLE
A L’ÉGARD DU PEUPLE PIED-NOIR
Une obsession a dominé le comportement des putschistes : l’obsession du 24 janvier 1960.
Quelques années plus tard, en effet, Challe a déclaré à Serges Jourdes en substance :
« Je voulais éviter à tout prix un nouveau 24 janvier ».
C’est un propos poussé jusqu’’à l’absurde. Challe savait très bien qu’il avait tout raté le 24 janvier 1960. Par manque de lucidité et de courage. Cette semaine des barricades fut avant toute chose, en effet, une occasion, excellemment privilégiée de sauver l’Algérie française.
Les futurs officiers putschistes exerçaient, à cette date, de prestigieux commandements. Ils occupaient des postes clefs dans la hiérarchie militaire et administrative de l’Algérie française.
Tout était entre les mains de Challe.
Il n’avait qu’un geste à faire. Qu’une décision à prendre pour renvoyer De Gaulle à Colombey, dans la meilleure hypothèse pour celui-ci.
Il a même disposé à un moment donné, d’un chef de gouvernement provisoire et disponible en la personne de Michel Debré, premier ministre de De Gaulle. Premier ministre qui n’était pas à un reniement près. Lorsque Debré est venu à Alger exercer sa propagande auprès des colonels crédules de la 10ème DP en particulier, ceux-ci n’avaient qu’à le contrôler pour qu’il lançât un appel au sauvetage de l’Algérie française. Ils disposaient des moyens de le « persuader ».
C’était l’occasion offerte par le ciel à Challe pour sauver cette terre qu’il semblait tant aimer.
Ni pour quelques-uns de mes amis, ni pour moi-même, cette guerre d’Algérie n’avait été une réelle surprise. En effet, le fiasco d’Indochine, les gâchis marocains et tunisiens rendaient historiquement nécessaire une rébellion algérienne.
J’entends l’adjectif « nécessaire » dans son sens philosophique. C’est-à-dire que le contraire eut été absurde et impensable.
De surcroît, nous étions conscients d’une chose : les opérations déclenchées par l’anti-occident, aussi bien en Indochine qu’au Maghreb, n’auraient de c.nséquences tactiques, exploitables par nos ennemis et profitables pour eux à l’échelon planétaire, qu’après la main mise sur le territoire algérien.
L’Algérie, c’était « un gros morceau » nécessaire, en effet, à la victoire de nos ennemis. A la victoire de l’anti-Occident.
Pour les plus avertis d’entre nous, j’ose dire que cette rébellion était secrètement espérée : car elle devait être l’occasion de donner enfin un coup d’arrêt à la nouvelle invasion idéologique et religieuse dont étaient inéluctablement menacées la France, l’Europe et l’Occident, grâce à une victoire dont nous ne doutions pas.
D’où venait cette foi en une victoire, alors que tous les combats précédents s’étaient soldés par des défaites ?
Ma réponse va vous surprendre. Notre foi s’appuyait sur la réalité suivante : l’existence en Algérie d’une masse populaire française. Qu’il s’agisse de la fraction européenne, légalement et charnellement francisée (Espagnols, Italiens, Maltais et même dans une proportion très réduite, Allemands ou Vikings) ou de la fraction française européanisée. Nous voulons dire fraction de souche entièrement métropolitaine certes, mais à qui ce brassage méditerranéen avait conféré une dimension de pensée plus européenne qu’hexagonale.
Plus encore, au sein de cette masse française, vivait un prolétariat français. Les partisans de l’indépendance, qu’ils fussent gaullistes ou socialo-communistes, désigneront plus tard ce prolétariat par le terme dédaigneux, riche de mépris discriminatoire de « petits blancs ».
Ce paramètre « masse française » était un élément nouveau dans la dialectique historique du moment : c’était un facteur humain qui nous paraissait infiniment plus important que les facteurs économiques, politiques et militaires. Dans notre candeur, nous pensions que la solidarité nationale n’était pas un terme vide de sens. Nous étions convaincus que la liberté et la survie d’un million de concitoyens au moins allaient devenir une préoccupation dominante et angoissante pour la majorité du peuple français. Celle qui vivait sur le sol de la mère patrie, à laquelle nous rêvions, nous les Pieds-Noirs d’Algérie, avec amour et tendresse. Nous ignorions tout de cette prévention que pouvaient nourrir les métropolitains dans une large proportion à l’égard de leurs concitoyens d’outre-mer. Prévention alimentée par un sentiment sous-jacent qui ressemblait en réalité à de la jalousie. Ou plutôt à un complexe d’infériorité ressenti contre ceux qui affirmaient leur ambition de représenter la mère patrie au-delà des mers. De vouloir la défendre au loin, au-delà de la Méditerranée. Prévention alimentée plus tard de la bonne morale décolonisatrice : « Vous n’aviez rien à faire là-bas. Vous êtes allés voler les terres de ces pauvres gens ».
Nous étions ainsi décrits dans leur langage, comme des voleurs, des exploiteurs, des négriers.
« Qu’ils partent ou qu’ils crèvent, ces Pieds-Noirs, mais qu’on n’en parle plus ! »
Dans notre candeur, nous, les « lointains » ignorants de cet état d’esprit, pensions jouir d’un élan de solidarité de leur part, identique à celui qui avait animé nos anciens à l’égard de la mère patrie, en d’autres circonstances tragiques.
Dans ces nouvelles circonstances de la guerre d’Algérie, officialisée comme telle par la loi du 18 octobre 1999 ne l’oublions jamais, comment ignorer cette masse de Français, ce peuple français, pris de plein fouet par le conflit ! Peuple français qui allait conférer à la guerre d’Algérie, sa signification réelle et sa dimension véritable : celle d’un conflit de civilisation, d’un conflit supranational que l’histoire imposait à la France de résoudre par une victoire. Pour éviter de subir les effets d’une défaite. Devant l’arabo-islamisme fondamentaliste.
Il n’existait aucune solution intermédiaire. La France devait gagner cette guerre pour sa propre défense, pour la défense et la survie de l’Europe, pour la défense du « cœur du monde »[sup]3[/sup].
Ce n’est pas en 1961, je le souligne pour la millième fois, mais en 1955 qu’aurait dû naître l’OAS. C’est en 1955 que la masse des Européens d’Algérie aurait dû comprendre que le destin de la France en Algérie reposait avant tout sur sa volonté de prendre part au combat. Ils représentaient une force à la seule condition de s’unir. Mais j’ignorais à cette époque, comme je le constate à chaque instant aujourd’hui, qu’unir des Pieds-Noirs, c’est de l’utopie ! De nos jours encore, la collectivité des Français d’Algérie est gangrénée par un esprit de division pourrisseur et assassin. Un esprit qui nous a tués en Algérie. Qui risque de nous ridiculiser aujourd’hui, dans l’expression de notre « mémoire ».
Il fallait dévaloriser les Pieds-Noirs aux yeux de nos compatriotes métropolitains. Au lieu de solliciter leur enthousiasme, de stimuler leur envie de paraître d’abord et d’en découdre ensuite, on les a laissés croupir intentionnellement dans de piètres consignes de garnison.
Une décision désastreuse, logique, attendue, allait tomber comme un fruit mûr :
démobilisation officielle des disponibles d’Algérie, mobilisation des disponibles de métropole pour les remplacer.
On ne manqua pas de présenter cette nouvelle initiative comme une mesure absolument nécessaire au sauvetage de l’Algérie française. Le gouvernement de la IVe République, le justifia de la manière suivante :
d’une part, la vie économique de l’Algérie ne serait pas paralysée puisque la majorité des Pieds-Noirs allait continuer de travailler ;
d’autre part, la mobilisation des disponibles métropolitains démontrait aux Français d’Algérie que le peuple de France s’engageait dans le combat,
le combat pour conserver l’Algérie à la France. Pour protéger en même temps « la fraction vivante de la nation française » c’est-à-dire le peuple français d’Algérie, contre le massacre qui le menaçait.
Grâce à ces deux motivations alléguées par le pouvoir, les Français d’Algérie ont vécu cette décision anormale et sournoise, avec une désinvolture difficile à comprendre aujourd’hui encore.
Ils ont accepté que seuls les disponibles métropolitains aillent au combat pendant qu’eux-mêmes se rendaient tout normalement chaque jour à leur travail, à la plage et aux différents spectacles. Parfois même en vacances ou en cures thermales, sur le territoire métropolitain.
Le gouvernement de la IVe République avait élaboré et structuré, en cette occasion, une action psychologique très efficace qui eut l’effet néfaste, secrètement recherché : creuser entre les deux collectivités françaises de métropole et d’Algérie, un fossé que rien n’a jamais pu combler par la suite.
D’une manière officielle ce plan confinait les hommes valides d’Algérie dans le rôle subalterne de ceux qui travaillaient et de ceux qui priaient. Laissant à d’autres, la noble mission de combattre. Etant exclus des opérations militaires, on nous privait de l’estime de nombreuses familles de France. Au sein desquelles il manquait un fils ou un frère qui crapahutait peut-être quelque part, du côté de l’Akfadou et donnait la chasse à Amirouche et à ses bandes.
Voilà le traquenard dans lequel sont tombés ceux qui cependant nous disaient, à nous qui menions, les armes à la main, un combat clandestin pour la France depuis 1955 :
« De quoi vous mêlez-vous ? Laissez donc faire l’armée et la police ! »
Ils n’ont pas détecté le piège que l’on nous tendait. Piège qui s’exprimait de la manière suivante :
« Les Pieds-Noirs à la niche ! Cette affaire d’Algérie, ce n’est pas votre affaire. »
Pour les conjurés permanents contre l’Algérie française, tout particulièrement actifs dans les hautes sphères du capitalisme financier, il fallait activer le pourrissement de la situation. Il importait de conférer à cette guerre les aspects d’une guerre coloniale. Il fallait la convertir en une nouvelle guerre de conquête. Une guerre injuste, que plus tard on se permettra d’appeler guerre de libération pour les Algériens de confession musulmane.
Dans le déroulement de cette mascarade, on ne laissera pas passer l’occasion de faire tuer quelques milliers de soldats français, quelques milliers de Pieds-Noirs, quelques centaines de milliers de musulmans. De laisser lyncher sans réagir des dizaines de milliers de Harkis. De tolérer l’enlèvement de plusieurs centaines de nos concitoyens dont on ne sait rien, aujourd’hui encore, du sort qui leur fut réservé.
Qu’importaient la liberté et la vie d’un million de Français d’Algérie !
Ce travail de sape mis en œuvre à partir de la notion perverse de « Pieds-Noirs planqués » de « Pieds-Noirs qui gagnent de l’argent » pendant que les soldats du contingent risquaient de se faire casser la gueule dans le djebel, fut à l’origine d’un remarquable succès remporté par l’anti-France. Hier comme aujourd’hui d’ailleurs.
On a refusé de mettre la province française du sud de la Méditerranée, en situation de guerre totale. On n’a pas voulu transmettre au peuple français d’Algérie et à la majorité des musulmans français partisans de la France, l’enthousiasme militaire qu’il faut savoir élaborer, en temps de guerre, pour qu’une troupe et un peuple soient pugnaces et efficaces.
Cette déconsidération à l’égard du peuple pied-noir s’est confirmée avec un morne éclat le 22 avril 1961. Lors du malheureux putsch.
Une belle occasion cependant de sauver la France Sud-Méditerranéenne. C’est-à-dire avant tout une gigantesque et merveilleuse tête de pont enfoncée jusqu’au cœur de l’Afrique. Une tête de pont qui plongeait jusqu’aux confins de la Mauritanie, du Mali et du Niger. Une tête de pont qui aurait changé le destin de l’Afrique, de la France et du monde.
Mais, l’Union Minière du Congo, les grandes sociétés d’investissements du capitalisme financier ont négligé les peuples au bénéfice exclusif de la valeur ajoutée des investissements.
Les richesses de ces territoires, minières et agricoles, oui.
Mais les peuples, les populations,« gardez-les pour vous !»
QUATRIÈME EXPLICATION
LE COMPORTEMENT TROP COURTOIS,
TROP CIVILISÉ POUR NE PAS DIRE TROP NAÏF
DES PUTSCHISTES
Le comportement des putschistes va finalement les aveugler. Cette obsession de ne pas recourir à l’enthousiasme populaire de l’Algérie française explique, en effet, qu’ils n’ont pas vu.
« Ils n’ont pas vu…. Quoi ? »
Ils n’ont pas vu que De Gaulle, quant à lui, ne l’avait pas négligé… cet enthousiasme populaire. L’enthousiasme populaire de l’anti-France. Il le suscita, il le provoqua et il le nourrit de main de maître, en Algérie, au début du mois de décembre 1960.
Cet événement de décembre 1960, il faut le définir comme L’ANTI 13 MAI 1958. Grâce à des hommes liges, comme François Coulet par exemple, le chef de l’Etat appela les musulmans à manifester dans la rue, sous la protection des forces de l’ordre françaises, pour crier en même temps :
« Yahia De Gaulle !
Yahia FLN ! »
C’est-à-dire « Vive De Gaulle et Vive le FLN »
Par ces journées de décembre, De Gaulle prétendait démontrer à l’opinion publique que le peuple musulman d’Algérie s’était soumis au FLN et qu’il réclamait l’intervention de Charles De Gaulle pour accéder à l'indépendance. En cette occasion, celui-ci s’est révélé sans aucune ambiguïté, comme un agent de l’anti-France, comme un agent de l’agresseur de la France, puisque les évènements d’Algérie ont été officiellement identifiés à une guerre par la Ve République.
Il inaugura son parcours en Algérie, à partir de l’Oranie, d’Aïn Temouchent, dans des conditions qui nous couvrent, aujourd’hui encore, nous les partisans de l’Algérie française, d’un ridicule qui devrait nous faire honte : en effet, toutes les conditions étaient réunies pour qu’il pût être abattu. Or, rien ne fut tenté dans cette ville d’Oranie.
Lorsque des années plus tard je posai la question suivante à Toulouse, mon grand ami et frère d’armes le regretté Yvan Santini :
« pourquoi n’as-tu pas fait tuer De Gaulle à Aïn Temouchent ? »
il me répondit avec une sincérité désarmante :
« j’aurais pu le faire, mais je n’avais pas d’ordre ! ».
J’ai commenté ce propos avec lui. Nous éprouvâmes la conviction que nous avions laissé passer ce jour-là, peut-être, le sauvetage de l’Algérie française.
Je suis persuadé que De Gaulle était conscient du risque qu’il prenait en venant en Algérie. Mais il tenait à exprimer par-dessus tout son mépris des Pieds-Noirs et de l’armée, en agissant comme s’il avait voulu dire :
« Je viens en Algérie, parce que vous êtes trop couards et trop mal organisés pour tenter quelque chose contre moi. »
Que devaient faire les putschistes dès le 22 avril 1961 ?
De la même manière que De Gaulle, en décembre 1960, avait organisé « l’anti 13 mai 1958 », il fallait déclencher dans un enthousiasme français « l’anti-décembre 1960 » en Algérie.
J’ai insisté sur cette possibilité dans le cadre de la troisième explication. Le peuple d’Alger, le peuple d’Oran et derrière eux le peuple du Constantinois, auraient suivi l’armée engagée dans ce combat ultime pour sauver l’Algérie française, défendre la France et l’Occident. L’anti-décembre 1960, c’est-à-dire le putsch du 22 avril, devait s’identifier à l’opération salvatrice de l’Algérie française qu’il fallait exhiber devant la France et le monde entier.
Les putschistes n’avaient aucune raison de ménager le chef de l’Etat. Car ils auraient dû se souvenir des pusillanimités successives et historiques de Charles De Gaulle.
Pendant la campagne de France, on a trop écrit sur le comportement du colonel De Gaulle, pour attacher de l’importance à des commentaires serviles qui prétendent en faire un pseudo-héros d’un pseudo-combat de Montcornet.
Certains militaires ont souligné son comportement « anormal » devant Abbeville.
Néanmoins, De Gaulle était connu dans certains milieux de chasseurs de têtes, comme un auteur ayant publié des écrits qui le situaient à l’avant-garde, prétendait-on, des nouvelles techniques et des nouveaux équipements militaires. Dans un livre fort riche en informations, « Les Mémoires d’un président » l’auteur que l’on peut identifier sans effort à Paul Reynaud lui-même, n’hésite pas à dire de De Gaulle qu’il était « écrivaillon par goût, militaire par erreur ». Celui-cifut néanmoins choisi par ces chasseurs de têtes.
Choisi en particulier par qui ?
Par la maîtresse du président du Conseil, la comtesse de Portes, dont on écrit qu’elle faisait partie du Mouvement Synarchique International. Elle l’a fait nommer général de brigade, à titre temporaire et sous-secrétaire d’Etat à la guerre, dans le gouvernement de Paul Reynaud. Cette nomination providentielle a permis surtout à De Gaulle de se soustraire à l’autorité du général Weygand.
Dans une étude précédente, j’avais évoqué les circonstances du départ à Londres du général De Gaulle en juin 1940.
De Gaulle, sous-secrétaire d’Etat à la guerre, avait reçu la mission de Paul Reynaud de le précéder à Londres. Paul Reynaud prétendait y continuer la lutte, en accord d’ailleurs avec Winston Churchill. C’était donc en tant qu’officier de liaison que De Gaulle s’est rendu, sur ordre, à Londres et non pas pour y organiser la résistance.
Dans ce livre, « Les Mémoires d’un président », l’auteur souligne les peurs manifestées par De Gaulle. Celui-ci, à l’instant de l’embarquement exhiba ses craintes et sa panique, qui lui firent refuser ce départ. D’après l’auteur, il fut happé contre son gré et introduit de force dans la carlingue de l’avion par le général Spears et le lieutenant de Courcelles.
C’est donc contre sa volonté que De Gaulle s’est rendu à Londres. Son génie fut, une fois sur place, de ne pas avoir raté l’occasion d’exploiter pour son profit personnel et exclusif, l’accident de la route dont furent victimes Paul Reynaud et sa maîtresse. De Gaulle se révéla ingrat à l’égard de la comtesse dont il ne voulut plus entendre parler. Ingrat ? Pourquoi ? Parce que c’est à la comtesse de Portes qu’il devait sa nomination au grade de général de brigade à titre temporaire et de sous-secrétaire d’Etat à la guerre. Mais De Gaulle, tout le monde le sait, est un mauvais débiteur.
En 1946, De Gaulle abandonne le pouvoir, purement et simplement, devant la pression des communistes. Je me souviens du discours lamentable qu’il prononça pour expliquer sa désertion devant l’ennemi communiste. Les Gaullistes, « vont se sentir orphelins », écrit Alain Peyrefitte.
A Alger, nous, les élèves du lycée Bugeaud, du moins ceux qui en 1946 avaient le courage d’affirmer qu’ils étaient anti-communistes, décidâmes de manifester dans la rue pour provoquer un retour au pouvoir du général De Gaulle.
Nous refusions que le pouvoir fût abandonné aux suppôts de Staline en 1946. Nous espérions que le général allait se reprendre et vaincre sa couardise de l’époque.
Je me souviens d’avoir défilé dans les rues d’Alger au cri de « Vive De Gaulle » et « De Gaulle au pouvoir » en 1946, je le rappelle.
Un spectateur de la rue, très bourgeoisement vêtu, nous regardait défiler avec ahurissement. Cet homme, manifestement distingué et cultivé, s’est exprimé devant notre enthousiame grotesque et ridicule par une apostrophe qui se voulait agressive :
« Ah nous sommes jolis ! »
Cette phrase ne mérite pas d’être retenue si vous vous refusez de la prononcer avec l’accent pied-noir.
En pensant à ce respectable compatriote, il m’arrive de considérer que tous les ennuis, avatars, problèmes et drames que j’ai personnellement vécus plus tard, illustrent un châtiment du ciel que je méritais pour avoir crier « Vive De Gaulle » une fois dans ma vie. C’était en 1946.
La nomination de De Gaulle au grade de général de brigade à titre temporaire, mérite que l’on s’y attarde un peu. Il s’agit de faire toucher du doigt que la comtesse de Portes, maîtresse de Paul Reynaud, la « salope » telle qu’on l’appelait dans l’entourage de De Gaulle, jouissait d’un pouvoir suffisant pour obtenir cette nomination.
En effet, à cette époque, la nomination des généraux s’effectuait en conseil des ministres. Le général Galiffet explique dans son livre « Le Sabreur de la Commune » comment il avait suggéré à Waldeck Rousseau de mettre en place ce processus de nomination des généraux. C’était au moment de l’agitation boulangiste au cours d’un entretien que les deux hommes ont tenu à la brasserie Lipp à Paris.
En 1960, lors des Barricades d’Alger, De Gaulle, on veut le cacher aujourd’hui encore, manifeste une fois de plus sa pusillanimité.
Il envoie Debré à Alger, de toute urgence, pour calmer les ardeurs patriotiques des officiers parachutistes. Debré, premier ministre du général, va être confronté à Argoud et à tous les officiers de la 10ème DP. Il va leur affirmer, sur sa parole d’honneur, que De Gaulle allait choisir la solution la plus française.
Quelques jours plus tard, De Gaulle déclare en substance aux patriotes d’Alger, civils et militaires : « comment pouvez-vous douter que De Gaulle ne choisira pas la solution la plus française pour l’avenir de l’Algérie !». Ce propos suffit à décérébrer tous les officiers. Ceux-ci représentaient pourtant un énorme potentiel d’action s’ils avaient été clairvoyants durant cette semaine. Si De Gaulle s’est livré à cette affirmation, c’est parce qu’il avait eu la trouille. Car lui savait très bien qu’il avait tout à redouter durant cette Semaine des Barricades.
En 1968 De Gaulle, devant les manifestations et l’agitation révolutionnaire qui secoue la mère patrie va prendre la fuite. « Massu, au secours ! ». Voilà qui résume l’attitude de l’homme de Colombey. On a trop écrit sur ce chapitre pour que j’insiste sur cet épisode grisâtre, un de plus, de notre histoire.
En 1969, le référendum imposé aux Français par De Gaulle, dit « NON !». De Gaulle ne l’accepte pas. Il quitte le pouvoir, manifestant ainsi, officiellement, son manque de considération pour le suffrage universel. Il retourne dans sa maison. Il y attend en réalité, que puisse s’accomplir une seconde parousie. Car dans son comportement paranoïaque, il ne doute pas que la masse des Français allait le rappeler au pouvoir une fois de plus… lui le « sauveur perpétuel de la France ». Cette fois, il attendra en vain.
De Gaulle s’est révélé comme un homme-outil de grand luxe, pour le capitalisme financier.
Il fut l’exécuteur historique du « délestage économique du débouché algérien ». L’auteur du livre « Les mémoires d’un président » écrit en substance : « il serait temps que l’on écrive l’histoire de la conjonction De Gaulle-Rothschild ». Ajoutons qu’il serait temps de s’intéresser au rôle néfaste de la secte pompidolienne…. Qui d’ailleurs, organisa la défaite de De Gaulle en 1969. Parce que celui-ci ne lui était plus utile.
En 1940, détecté comme un homme de main de grande valeur, De Gaulle fut « entrepris » par la comtesse de Portes.
Cette femme avait l’habitude d’évaluer la réceptivité de ses interlocuteurs masculins aux réactions de leur appendice sous-pubien. Et l’auteur de ce livre suggère qu’elle aurait bien voulu exercer ses charmes, non pas auprès du général de brigade à titre temporaire De Gaulle, mais auprès du maréchal Pétain qui détenait le pouvoir en 1940.
Je ne puis résister à l’envie de revenir sur la personnalité de ce grand officier français. Pétain, colonel ancien à Arras, eut à recevoir un jour le colonel Grandmaison, professeur à l’école de guerre. Celui-ci était venu enrichir le savoir des officiers du régiment commandé par Pétain, des techniques modernes d’offensive, à mettre en pratique dorénavant. Les vagues d’assauts de fantassins, à la baillonnette, étaient décrites comme le moyen le plus efficace pour enlever une position détenue par l’ennemi. Pétain, convaincu que sa retraite était proche, ne s’est pas départi de son habituel franc-parler. S’adressant aux officiers du régiment, auditeurs de la conférence du colonel Grandmaison, il leur déclara sans état d’âme, en substance :
« Ce que vient de vous exposer le colonel Grandmaison est tout le contraire de ce qu’il faut faire. Avant d’attaquer une position ennemie, il faut l’écraser sous la puissance du feu ».
Pétain était sur le point de prendre sa retraite et c’est le général Franchet D’Esperey, né en 1856 à Mostaganem, qui, quelques mois avant la déclaration de guerre de 1914 alerta le Conseil des ministres pour que l’on nommât Pétain au grade de général de brigade.
De Gaulle fut donc appelé en 1940 par Paul Reynaud qui en avait fait son officier de liaison auprès de Churchill.
Les Britanniques durant la désastreuse campagne de France, étaient conscients d’une nécessité absolue. Il fallait à tout prix arrêter l’armée allemande, le plus loin possible des Pyrénées. Car ce qui était vital pour eux c’était de soustraire le général Franco, en Espagne, à l’influence de ses faucons. Ceux-ci, éprouvant encore l’enthousiasme de la victoire franquiste de 1939, ne voulaient pas laisser passer l’occasion d’utiliser l’armée allemande victorieuse pour reprendre Gibraltar aux Britanniques. Pour réintégrer ce port militaire à l’Espagne.
Samuel Hoare, spécialiste de l’aviation, fut nommé en 1940 à Madrid comme ambassadeur d’Angleterre par Winston Churchill dans un but bien précis. Tout faire pour que l’Espagne restât neutre. Car Gibraltar c’était « les Thermopyles » de l’empire britannique. C’était la clef de la Méditerranée. Si l’Espagne s’engageait dans la guerre, au côté de l’Axe, l’Allemagne était en mesure de verrouiller la Méditerranée à l’ouest, grâce à la prise de Gibraltar. Les conditions d’une victoire allemande étaient peut-être réunies. Par quelque moyen que ce fût, il fallait à tout prix arrêter l’armée allemande le plus loin possible des Pyrénées.
Ce fut l’objectif opérationnel attribué au maréchal Pétain. Quand il était encore ambassadeur de France en Espagne. L’armistice obtenu par celui-ci au mois de juin 1940 avait comme but stratégique d’arrêter les panzers du général Guderian le plus loin possible des Pyrénées.
Ce jour de l’armistice, Hitler a perdu la guerre et il ne le savait pas.
Les deux vainqueurs réels d’Adolphe Hitler furent historiquement :
le général Franco, parce qu’il a su résister à la pression de ses « Faucons », ultra-nationalistes espagnols qui voulaient saisir la balle au bond pour enlever Gibraltar aux Britanniques. Et parce que plus tard, à Hendaye, Franco refusa à Hitler le passage de ses troupes pour enlever Gibraltar. Ce jour-là le chancelier du Reich a dû regretter d’avoir accepté l’armistice sollicité par Pétain.
Le maréchal Pétain, par sa décision de demander un armistice, protégea les ultra-nationalistes espagnols contre une contagion d’enthousiasme. Ce jour de l’armistice illustre militairement et historiquement le jour de la défaite stratégique d’Adolphe Hitler.
J’ai suggéré, en m’appuyant, sur les écrits des « Mémoires d’un président », que la comtesse de Portes avait tenté une approche auprès du chef de l’Etat français, Philippe Pétain. Mais celui-ci lui refusa sa porte, comme le souligne le « Président ».
Horreur ! Qu’ai-je osé suggérer ?
Mon copain Raymond a piqué une crise de colère, que je ne comprends pas.
Ou bien il a lu trop rapidement ce que j’ai écrit, ou bien il n’a pas tout compris.
Je n’ai jamais dit que Pétain voulait « se faire » la comtesse. Je n’ai même pas dit que cette comtesse avait décidé de séduire le maréchal. J’ai rappelé ce que le « Président » suggère lui-même : la séduction sexuelle était l’argument majeur, pour ne pas dire exclusif, dont savait se servir la Du Barry de la 3ème République.
Raymond rappelle le grand âge du maréchal qui, d’après lui, devait le tenir à l’abri des tentations de la chair. C’est certain. Mais personne ne peut nier que le maréchal Pétain exerçait un charme indiscutable sur la gent féminine.
Que Raymond se rassure. Je n’ai jamais prêté au maréchal Pétain des intentions de courir encore le guilledou. Néanmoins je trouve regrettable que Raymond éprouve la nécessité de mettre en doute le charme que peuvent exercer certains hommes de 83 ans !
Il n’existait aucune raison historique majeure, pour les putschistes du 22 avril en Algérie, de ménager De Gaulle. L’homme qui a pris « beaucoup trop de libertés » avec la France, « qu’il a traitée comme sa chose ».
Il aurait fallu, surtout, ne pas rater la dernière occasion.
La dernière occasion ce fut l’occasion du 26 AVRIL 1961
Une occasion que le destin s’est entêté à offrir encore une fois aux militaires pour sauver l’Algérie française. J’en ai eu connaissance personnellement en 1963, par Patri. Ce brillant combattant du 1er REP, héros de multiples combats.
Le putsch se traînait lamentablement vers son agonie. La mort dans l’âme, les hommes de troupe, les sous-officiers et l’immense majorité des officiers se disposaient à obéir au général Challes, et à se soumettre, une fois de plus, à De Gaulle.
Un grain de sable a failli remettre tout en question. Une section du REP, commandée par un sergent chef, occupait encore le PC d’Alger Sahel.
Ce PC se situait très près de la cathédrale d’Alger. Lorsque vous vous situiez devant la cathédrale, en lui tournant le dos, vous aviez en face de vous l’archevêché, et au-delà, la Place du Gouvernement et la mer.
Sur votre droite, vous aviez la rue de Chartres et la rue de Lyre. Sur votre gauche la rue Bruce où se dressait la plus importante caserne de pompiers d’Alger. Le PC d’Alger Sahel se situait très près de cette caserne de pompiers.
Les ordres du sergent-chef étaient précis :
tirer sans avertissement au bazooka sur tout véhicule de la gendarmerie qui emprunterait la rue de la Lyre pour se rendre en direction du centre d’Alger.
Or, le soir du 26 avril, aucun contre-ordre n’était parvenu au sergent-chef qui commandait la section.
Et voilà qu’en début de soirée des véhicules de la gendarmerie empruntent la rue de la Lyre pour rejoindre la place du Forum.
S’y déroulait une dernière manifestation. Des milliers d’hommes, des civils algérois, étaient rassemblés en armes. Des légionnaires du REC étaient présents, eux aussi, avec leurs véhicules. La tension était extrême.
Les unités parachutistes et les commandos de chasse du commandant Robin en particulier, s’apprêtaient à quitter Alger, la mort dans l’âme. Les véhicules qui transportaient ces milliers de soldats hors d’Alger, n’hésitaient pas à faire retentir leur klaxon au fameux « ti-ti-ti-ta-ta » « al-gé-rie fran-çaise » et ils avaient tous déclaré :
« nous partons, mais au premier coup de feu nous revenons et cette fois on ne rigolera pas ».
Le sergent-chef commandant la section du REP qui occupait Alger-Sahel, s’apprête donc à tirer sur les véhicules de la gendarmerie, comme il en avait reçu l’ordre. Et voilà qu’à la seconde où il va déclencher le tir, dans un esprit de discipline outrancière, il décide d’informer le PC du régiment, le PC du 1er REP, qu’il va ouvrir le feu.
« Rouge[sup]4[/sup] va ouvrir le feu ».
Panique au PC du 1er REP. Le contre ordre est immédiatement donné à ce vaillant sergent-chef de s’abstenir de toute ouverture du feu.
Que se serait-il passé si le tir avait été déclenché ?
Tout pouvait repartir dans un esprit offensif. Car cette fois, les civils d’Alger étaient prêts à s’engager en armes, et par millier. Les commandos qui se trouvaient encore au Cap Matifou et à Maison Carrée, ainsi que les hommes du REP et du REC seraient repartis dans un esprit différent à l’assaut du pouvoir gaulliste. Ils auraient été rejoints par le 14ème et le 18ème RPIMA qui étaient en train de revenir d’Oran, abandonnés provisoirement par le peuple oranien qui n’avait pas participé au putsch.
Tout était possible.
Mais les putschistes ont tenu bon. Ils ont sauvé le gaullisme par leur refus d’engager une action qui fût véritablement révolutionnaire.
Il s’agissait pourtant, aussi, de la défense d’un peuple français, menacé de génocide, le peuple pied-noir. Dont le massacre avait été envisagé avec désinvolture par la majorité du peuple de métropole.
L’histoire jugera.
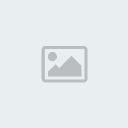
Note des administrateur du forum Chemin de mémoire des Parachutistes:
"
La photo cidessus est la propriété de Claude Legrand, ancien du 14°RCP membre du présent forum. Vous pouvez lui écrire"
Nice
Le 17 mai 2011
1 Colonnes d’Hercule : Détroit de Gibraltar
2 Etude 50/42 : A PROPOS DU CINQUANTENAIRE « LE PUTSCH DES GENERAUX 22-26 AVRIL 1961 ».
3 Cœur du monde : référence à un livre d’Harold Mac Kinder
4 Rouge : nom de code de son unité
16:17 Écrit par Ivan dans Débats, Histoire | Lien permanent | Commentaires (1) | Tags : algérie française, putsch d'avril 1961, oas, rep, parachutistes, jean-claude perez, de gaulle, islamisme, fln, aln |
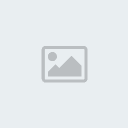
Facebook
source
source